
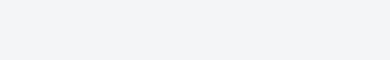
Langues:

Le document source utilisé pour ce Dossier dit:
Il est question dans cette section de deux possibilités assez différentes de stockage du CO2: la première est la carbonatation minérale, qui consiste à transformer par réaction chimique le CO2 en carbonates inorganiques solides; la seconde concerne l’utilisation industrielle du CO2, que ce soit directement ou comme charge afin de produire diverses substances renfermant du carbone.
Carbonatation minérale: technologie, impact et coût
Cette technique consiste à fixer le CO2 au moyen d’oxydes alcalins et alcalino-terreux, tels l’oxyde de magnésium (MgO) ou l’oxyde de calcium (CaO), que l’on trouve à l’état naturel dans des roches silicatées, par exemple la serpentine et l’olivine. Les réactions chimiques qui surviennent entre ces matières et le CO2 produisent des composés comme le carbonate de magnésium (MgCO3) et le carbonate de calcium (CaCO3, couramment appelé calcaire). Les quantités d’oxydes métalliques présentes dans la croûte terrestre excèdent celles qui seraient nécessaires pour fixer la totalité du CO2 que produirait la combustion de toutes les réserves actuelles de combustibles fossiles. Certains déchets industriels, par exemple les cendres et les scories de la production d’acier inoxydable, renferment également de petites quantités d’oxydes métalliques. La carbonatation minérale produit du silicate et des carbonates qui sont stables sur de longues périodes et que l’on peut donc éliminer dans des sites tels que des mines de silicate ou réutiliser dans la construction (voir la figure RT.10); la réutilisation risque cependant de porter sur de faibles quantités par rapport à celles qui sont produites. Le CO2 ne serait pas libéré dans l’atmosphère après la carbonatation. La surveillance des sites d’élimination serait donc peu utile car les risques sont restreints. Il est encore trop tôt pour évaluer le potentiel de stockage, mais celui-ci serait limité par la proportion des réserves de silicate exploitables, par des questions environnementales telles que le volume des rejets et par des aspects juridiques et sociétaux dans la zone d’entreposage.
La carbonatation minérale survient aussi naturellement, par le phénomène appelé «altération atmosphérique». C’est alors un processus très lent, qui doit être accéléré de manière considérable pour constituer une méthode viable de stockage du CO2 piégé aux sources d’émissions anthropiques. Les recherches conduites dans ce domaine s’attachent donc à trouver des modes de transformation qui produisent des taux de réaction suffisants pour une application industrielle et qui haussent le rendement énergétique de la réaction. La carbonatation minérale au moyen de silicates naturels en est à l’étape de la recherche, mais certaines méthodes utilisant les déchets industriels en sont au stade de la démonstration.
Une application commerciale comprendrait l’extraction, le broyage et le traitement des minerais et leur acheminement jusqu’à une usine de transformation qui recevrait un flux concentré de CO2 provenant d’un point de piégeage (voir la figure RT.10). L’énergie requise pour la carbonatation représenterait 30 à 50 % de la production de la centrale de piégeage. Si l’on tient compte du supplément d’énergie nécessaire pour piéger le CO2, un système de carbonatation minérale entraînerait une hausse de la consommation d’énergie de 60 à 180 % par kilowattheure produit, en comparaison d’une centrale électrique de référence ne procédant ni au piégeage, ni à la carbonatation minérale. Cet aspect majore fortement le coût de la tonne de CO2 évité (voir la section 8). Le cas le mieux étudié jusqu’à présent est celui de la carbonatation humide de l’olivine silicatée naturelle. Un tel procédé coûterait de 50 à 100 dollars É.-U./tCO2 net minéralisé (auquel s’ajoute le piégeage et le transport du CO2, mais en tenant compte des besoins énergétiques additionnels). La carbonatation minérale exigerait d’extraire 1,6 à 3,7 tonnes de silicate par tonne de CO2 et produirait 2,6 à 4,7 tonnes de matières à éliminer par tonne de CO2 stocké sous forme de carbonates. Il s’agirait donc d’une opération d’envergure, dont l’impact sur l’environnement serait comparable à celui d’autres grandes exploitations minières à ciel ouvert. La serpentine renferme souvent du chrysotile, une forme naturelle de l’amiante, ce qui nécessiterait des mesures de surveillance et d’atténuation similaires à celles prises actuellement par l’industrie extractive. En revanche, les produits de la carbonatation minérale sont exempts de chrysotile car il s’agit du composé rocheux le plus réactif et, donc, celui qui est converti le premier en carbonates.
Plusieurs questions doivent être éclaircies pour pouvoir évaluer le potentiel de la carbonatation minérale. Parmi celles-ci figurent la faisabilité technique du procédé et les besoins énergétiques correspondants à grande échelle, mais aussi la partie des réserves de silicate qui pourrait être exploitée, d’un point de vue technique et économique, pour stocker le CO2. L’impact de l’extraction minière, du rejet des déchets et du stockage des produits pourrait aussi restreindre les possibilités de mise en oeuvre. L’intérêt que présente la carbonatation minérale ne peut être déterminé à l’heure actuelle: il dépend en effet de l’importance des réserves de silicate, inconnue à ce jour, qu’il serait techniquement possible d’exploiter et des questions environnementales susmentionnées.
Source & ©:
GIEC,
![]()
7. La carbonatation minérale et les usages industriels, p.39-40
Le document source utilisé pour ce Dossier dit:
Le CO2 est utilisé comme réactif dans plusieurs procédés chimiques et biologiques, par exemple pour produire de l’urée et du méthanol, ainsi que dans diverses applications directes (horticulture, réfrigération, conditionnement alimentaire, soudage, boissons, extincteurs d’incendie, etc.). Les quantités utilisées à l’échelle mondiale sont actuellement de l’ordre de 120 MtCO2 par an (30 MtC/an) sans compter la RAP (voir la section 5). La majorité (deux tiers du total) sert à produire de l’urée pour la fabrication d’engrais et d’autres produits. Une partie est extraite de puits naturels, une autre provient de sources industrielles – en général des sources à forte concentration, telles les usines de production d’ammoniac et d’hydrogène – qui piègent le CO2 au cours de la production.
En principe, les usages industriels peuvent aider à prévenir le rejet de CO2 dans l’atmosphère en le stockant dans le «bassin chimique de carbone» (c’est-à-dire l’ensemble des produits finis qui renferment du carbone). Toutefois, du point de vue de l’atténuation des changements climatiques, une telle utilisation n’est valable que si les quantités en jeu et la durée du stockage sont importantes et si cela entraîne une réduction nette des émissions. La durée de vie moyenne de la majorité du CO2 qui entre dans les procédés industriels n’est que de quelques jours à quelques mois; le carbone stocké se transforme ensuite en CO2 et retourne dans l’atmosphère. Ces durées sont insuffisantes pour contribuer utilement à l’atténuation des changements climatiques. En outre, la consommation industrielle totale, soit 120 MtCO2 par an, est faible comparée aux émissions des principales sources anthropiques (voir le tableau RT.2). Bien que certains procédés industriels stockent une petite partie du CO2 (à peu près 20 MtCO2 par an au total) pendant plusieurs décennies, la quantité totale retenue à long terme (plusieurs siècles) se situe actuellement aux alentours de 1 MtCO2 par an ou moins, sans perspective d’augmentation majeure.
Une autre question importante est de savoir si les usages industriels entraînent une réduction nette des émissions de CO2, en remplaçant d’autres procédés ou produits industriels. On ne peut l’établir correctement qu’en considérant les limites propres au système, pour ce qui est des bilans énergie et matières des procédés qui emploient du CO2, et en effectuant une analyse détaillée du cycle de vie de l’application envisagée. Peu de textes ont été publiés sur le sujet, mais ils indiquent qu’il est difficile d’avancer des chiffres précis et que, dans bien des cas, les usages industriels pourraient globalement se solder par une augmentation nette, et non une réduction nette, des émissions. Vu la faible proportion de CO2 retenue, les quantités limitées utilisées et le risque d’accroître les émissions, on peut conclure que les usages industriels du CO2 piégé contribuent sans doute de manière modeste à l’atténuation des changements.
Source & ©:
GIEC,
![]()
7. La carbonatation minérale et les usages industriels, p.39-41

This summary is free and ad-free, as is all of our content. You can help us remain free and independant as well as to develop new ways to communicate science by becoming a Patron!